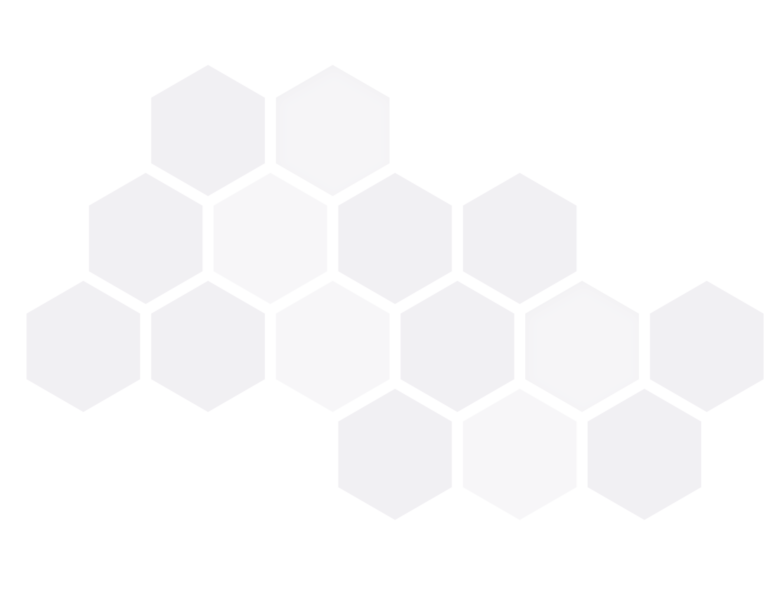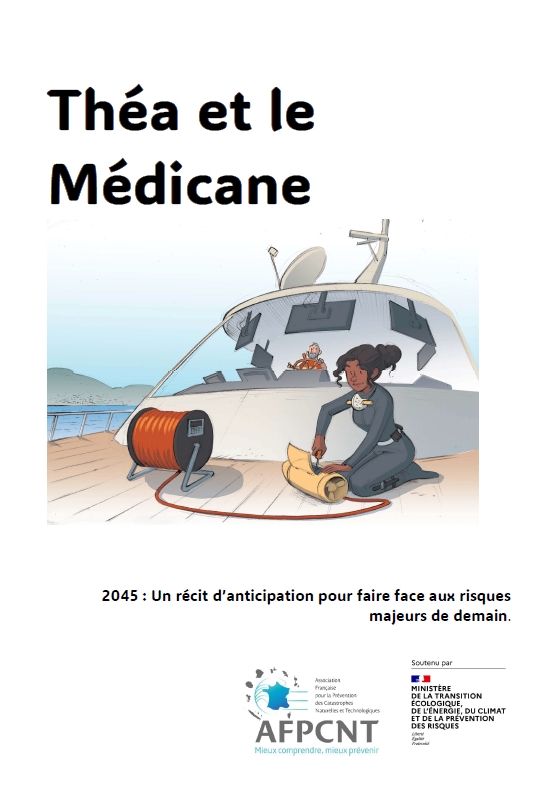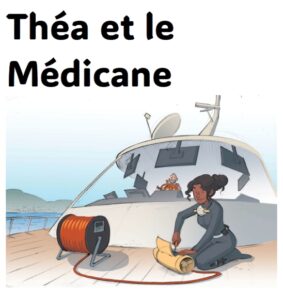
L’histoire de THEA ET LE MEDICANE est une vision d’un 2045 désirable, soutenable, et faisable, créée en prolongeant les grands courants du moment et en croisant les regards d’un panel de personnalités aux origines variées.
Ce livre expose un futur plausible dans lequel un territoire imaginaire – Pointe Blanche – est correctement préparé et organisé, où les risques sont connus et acceptés, et où les technologies sont des outils au service des citoyens et de la biodiversité.
Pourquoi ce livre ? Comprendre le besoin de visions alternatives sur les risques
Pour se projeter dans l’avenir, nous devons nous appuyer sur nos imaginaires contemporains. Or, ce que l’on nous dit de demain, dans nos romans d’anticipation comme dans nos séries télévisées, dans nos films de science-fiction, comme dans nos projections sociologiques et climatiques, ne fait pas franchement rêver.
On nous parle de réchauffement de la planète, d’épisodes météorologiques extrêmes, de hausse du niveau des océans, de crise de confiance dans les institutions, de technologies intrusives, de problèmes sociaux liés aux flux migratoires et au vieillissement des populations, et cetera.
Pas étonnant dans ce cas que les décideurs, les architectes, les ingénieurs et les politiques, les citoyens jeunes et moins jeunes se sentent angoissés…
Partant du principe que le pire est aussi incertain que le meilleur, que les plans, les images et les textes d’aujourd’hui ont un pouvoir sur le futur (les sociologues parlent de performativité) l’AFPCNT et le Pôle Safe, associés au laboratoire RASSCAS, ont décidé de fabriquer des images et des récits alternatifs, pour contribuer à créer des imaginaires porteurs de sens et d’espoirs qui permettront aux territoires de redécouvrir leurs capacités d’adaptation et de régénération face aux risques.
Ce petit livre est l’exemple d’un artefact, associant textes et images, qui propose une vision du futur à la fois réaliste et plausible, qui permet dès aujourd’hui d’envisager un avenir dans lequel nous avons appris à vivre avec les risques systémiques, ici par exemple la conjonction d’un épisode météorologique extrême provoquant un accident industriel. Ce genre de récit, en se diffusant dans la société, peut alors contribuer à alimenter une vraie « culture du risque » dans la société, sans attendre l’arrivée d’une catastrophe, réelle.
Qui a fabriqué ce récit ? Un collectif qui devient auteur
Le récit qui suit est le fruit d’un processus de plusieurs semaines (de Juillet à Décembre 2024), impliquant des citoyens, des spécialistes des risques, de l’énergie, des technologies, des ingénieurs, des sociologues, des artistes, réunis à l’initiative de l’ Association Française pour la Prévention des Catastrophes Naturelles et Technologiques (AFPCNT), qui est un centre national de réflexion collective transversale et multirisque sur la problématique des risques naturels et technologiques et un acteur reconnu pour ses travaux en matière de culture du risque et de résilience en France.
Dans cette démarche, l’AFPCNT s’est associée au pôle de compétitivité SAFE, qui fédère près de 500 adhérents majoritairement situés en Région Sud et dont deux tiers sont des entreprises En 2023, SAFE a décidé de renforcer sa stratégie en identifiant de grands défis sociétaux auxquels la société doit faire face, et vis-à-vis desquelles ses filières doivent se positionner. La résilience territoriale figure au premier rang de ces défis.
RASSCAS, le laboratoire de Recherche Appliquée en Sciences Sociales pour Concevoir une Anthropocène Soutenable, unité de recherche d’une école d’ingénieurs, l’ISEN Méditerranée, a été choisi pour animer la fabrication de ce récit. Pour ce faire, les chercheurs de RASSCAS ont utilisé la méthode APIS (Atelier de Production d’Imaginaires Soutenables). Cette méthode s’appuie sur des travaux scientifiques antérieurs, comme ceux de Bruno Latour, de Johana Macy, de Joseph Campbell ou encore d’Otto Scharmer. Elle propose à un collectif d’entrer dans un processus de fabrication de récits pour des imaginaires soutenables.